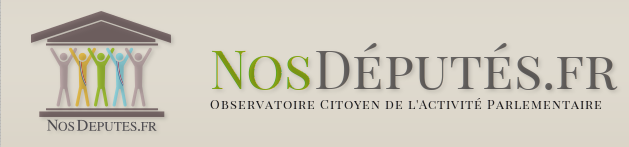Intervention de Stéphane Le Bars
Réunion du jeudi 8 février 2024 à 14h00
Commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre
L'USPA représente aujourd'hui plus de 200 sociétés de production de fictions, de documentaires et de spectacles vivants. Pour sa part, AnimFrance représente plus d'une soixantaine de studios de productions d'animation.
Le tissu de la production audiovisuelle est riche, concurrentiel et dynamique. Sur ce marché, la France occupe désormais une place essentielle en Europe et dans le monde. C'est un vecteur important de la consolidation du marché européen. Elle compte des groupes indépendants, mais aussi des filiales et des éditeurs de services tels que Newen ou StudioCanal.
La production audiovisuelle est protégée par un dispositif ambitieux, qui est envié partout dans le monde. Il est étudié avec beaucoup d'attention par nos homologues européens, et nombre d'entre eux y voient une source d'inspiration.
Notre réglementation est équilibrée et met au centre la création. Ce système vertueux a fait ses preuves, comme l'attestent les résultats de la production audiovisuelle française à l'échelle européenne et mondiale, mais aussi l'activité des diffuseurs. Il suffit de penser au lancement récent de la plateforme TF1+. Cette dernière a été lancée grâce à l'accord interprofessionnel signé par les syndicats de producteurs audiovisuels avec le groupe TF1 en novembre 2022. D'autres accords ont également été conclus entre les syndicats et TF1, NRJ, M6, Orange, Altice, mais aussi avec des plateformes américaines (Amazon Prime et Netflix).
Ces accords s'appuient sur les décrets existants, que nous jugeons équilibrés. Les derniers décrets TNT, câble-satellite et SMAD ont marqué des avancées importantes pour les groupes audiovisuels, puisqu'ils prévoient une baisse significative de l'accès aux parts de coproduction. Ces groupes ont désormais la possibilité de détenir des droits à 360 degrés dès lors qu'ils financent une œuvre à 50%, ce qui leur permet de développer l'activité de vidéo à la demande ( video on demand ou VOD) gratuite qui va rencontrer l'évolution des usages. En contrepartie, le décret limite les droits à trente-six mois, et le producteur peut contrôler sa distribution lorsqu'il a fait l'effort d'intégrer cette activité.
Ainsi, le décret apporte des avantages pour les éditeurs de services, pour les producteurs et pour les distributeurs. Une négociation s'engage ensuite entre l'ensemble des parties afin de trouver un équilibre entre les stratégies des différents groupes. Les accords signés montrent qu'il est parfaitement possible de trouver des points de convergence entre les intérêts de chacun.
La proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, dite « proposition de loi Lafon », adoptée au Sénat en juin 2023, risque de déséquilibrer cette relation en détricotant une nouvelle fois la définition de la production indépendante dans le secteur audiovisuel. Elle s'attaque en particulier à la question du contrôle des mandats de distribution.
Antoine Boilley a rappelé qu'en 2022, les éditeurs linéaires et non linéaires ont investi 1,6 milliard d'euros dans la production audiovisuelle et cinématographique, dont près de 400 millions d'euros pour les SMAD. En revanche, il est à noter que l'investissement des éditeurs historiques dans la production audiovisuelle et cinématographique n'a pas progressé : entre 2012 et 2022, il est passé de 1,3 à 1,2 milliard d'euros. Il s'ensuit que la croissance est essentiellement tirée par l'intégration des plateformes SMAD dans le paysage réglementaire.
Les SMAD représentent d'ores et déjà 25 % de l'investissement global dans la production audiovisuelle, soit un peu moins de 300 millions d'euros. Or cet investissement se concentre sur un nombre d'œuvres très réduit. L'essentiel de la production audiovisuelle et cinématographique restera donc fortement dépendant des éditeurs historiques.
La santé financière de ces éditeurs, qu'ils soient publics ou privés, est au centre de nos préoccupations. Il est grand temps de se préoccuper de leurs ressources. D'après une étude de l'Arcom et de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) publiée le 30 janvier 2024, les recettes publicitaires des acteurs historiques en matière de télévision s'élevaient à 3,5 milliards d'euros en 2022. Si le cadre réglementaire demeure inchangé, ces recettes devraient tomber à 3,1 milliards d'euros en 2030, soit une perte de 10 %.
Par ailleurs, la part des médias investissant en amont dans l'information et la création audiovisuelle et cinématographique devrait passer de 40 % à 29 % entre 2022 et 2030. Nous assistons à un krach des ressources de l'ensemble de nos acteurs produisant de l'information et de la création, au profit de plateformes numériques qui n'investissent pas dans la création en amont. C'est donc un enjeu essentiel pour la production audiovisuelle et cinématographique que de permettre aux éditeurs historiques de retrouver une dynamique d'investissement.
S'agissant du financement de l'audiovisuel public, je ne citerai qu'un chiffre éloquent : le programme national de France Télévisions a baissé de plus de 15 % au cours des dernières années. Face à la concurrence des grands acteurs internationaux, nous avons besoin d'un audiovisuel public fort en termes de financement.